
« La vie est un chemin de rosée dont la mémoire se perd. »
Qui se souviendra de nous lorsque nous nous serons éteints, si nous ne laissons derrière nous aucune famille, aucun ami, aucun héritage, aucune trace ?
Préserver la mémoire et l’œuvre de son maître, tel a été le souci de Matabei après l’événement.
Lui-même hanté par ses souvenirs, Matabei se réfugie à la pension de dame Hison, asile de tous ceux qui cherchent à fuir le monde, à s’isoler et mener une vie discrète et libre.
Le cadre est enchanteur. Le jardin, soigneusement entretenu par le maître puis par Matabei, offre un petit aperçu terrestre du Paradis.
Mais cette vie édenienne prendra fin, tout comme dans l’histoire biblique, dès lors que le péché aura été commis. Plus qu’à une chute, c’est à l’apocalypse que Matabei soit survivre.
Hubert Haddad parvient talentueusement à immerger son lecteur dans l’atmosphère douce du Japon. A l’instar des pensionnaires de dame Hison, le lecteur se sent hors du temps et se laisse bercer par la plume délicate et poétique de l’auteur. De nombreuses descriptions sont tout autant d’hommages à la nature luxuriante et pleine de vie de ce coin de l’archipel nippon. Les lecteurs de Pays de neige de Kawabata ressentiront comme un air familier à la fois par l’intrigue liant les personnages et par cette préséance accordée à l’environnement. Cette lecture onirique peut toutefois gêner par la surabondance de ces descriptions qui provoque à terme un effet répétitif et lassant.
Heureusement, la dure réalité se rappelle inopinément aux personnages et au lecteur. La lecture s’accélère, la rupture avec ce qui précède est évidente et radicale. La nature luxuriante cède sa place à un paysage de mort et de désolation. Après l’insouciance et la douceur de vivre, c’est l’errance et la tentative de retrouver ce qu’on a perdu. Mais il est plutôt temps de laisser les fantômes s’éloigner et de songer à la trace que l’on veut laisser de notre passage sur Terre. Matabei tente d’exorciser ses vieux démons en restaurant les éventails abîmés de son maître afin de transmettre ce patrimoine et d’encrer dans le papier de riz ses liens intimes et solides entre maître et élève, liens de substitution aux liens parentaux brisés ou perdus.
Le peintre d’éventail est un roman contemplatif d’une grande beauté. On y retrouve des traits communs à d’autres œuvres d’Hubert Haddad : la solitude, la perte de ses parents, la trahison, la nature, les conséquences désastreuses des actions humaines. Après la guerre dans Opium Poppy, c’est la dangerosité de la science qu’Hubert Haddad pointe du doigt en insérant le fictionnel dans la réalité par l’évocation du drame de Fukushima.
Le drame est matériel, environnemental, humain mais aussi sentimental, les personnages subissent le choc et le lecteur n’est pas épargné. En tout cas, ma sensibilité a fait qu’un détail inattendu de l’intrigue entre les personnages m’a à ce point surprise et attristée que j’en ai versé une larme.
L’Homme est dangereux pour la nature, la nature est dangereuse pour l’Homme. Face à sa puissance, nous ne sommes que grains de poussière aussitôt balayés d’un coup d’éventail.
Un grand merci à Anna et aux éditions Folio.





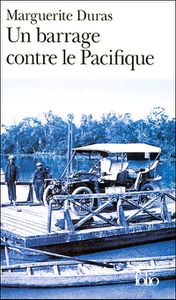 Ma première lecture de Marguerite Duras remonte à presque vingt ans. J’avais lu L’Amant suite à l’étude d’un extrait pour le bac ( j’étais même tombée dessus à l’oral). Le souvenir que j’en garde se limite à des impressions dues au cadre de l’intrigue, l’Asie coloniale, la chaleur, l’atmosphère lourde, quelques visions de persiennes laissant filtrer les rayons du soleil et les clameurs de la rue mais aussi et surtout un profond ennui.
Ma première lecture de Marguerite Duras remonte à presque vingt ans. J’avais lu L’Amant suite à l’étude d’un extrait pour le bac ( j’étais même tombée dessus à l’oral). Le souvenir que j’en garde se limite à des impressions dues au cadre de l’intrigue, l’Asie coloniale, la chaleur, l’atmosphère lourde, quelques visions de persiennes laissant filtrer les rayons du soleil et les clameurs de la rue mais aussi et surtout un profond ennui.  J’ai longtemps hésité avant de me lancer dans la rédaction de cette chronique. Parce que Céline a déjà été commenté maintes et maintes fois par des spécialistes et que je ne me sentais pas de taille à me plier à l’exercice. C’est toujours un peu comme ça lorsqu’on lit un monument de la littérature, ça intimide. Et lorsqu’en plus c’est un coup de cœur, on est au bord du découragement.
J’ai longtemps hésité avant de me lancer dans la rédaction de cette chronique. Parce que Céline a déjà été commenté maintes et maintes fois par des spécialistes et que je ne me sentais pas de taille à me plier à l’exercice. C’est toujours un peu comme ça lorsqu’on lit un monument de la littérature, ça intimide. Et lorsqu’en plus c’est un coup de cœur, on est au bord du découragement. 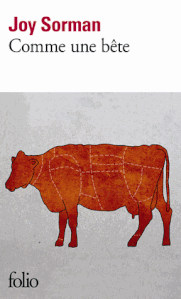 Jusqu’à la Renaissance, aucune distinction n’était faite entre l’art et l’artisanat telle qu’elle est faite de nos jours. Aujourd’hui, la différence entre les deux nous paraît évidente. Pourtant Joy Sorman réussit dans ce très (trop) court roman à rendre aux métiers de la boucherie leurs lettres de noblesse surtout dans le contexte actuel où la consommation de viande est de plus en plus critiquée.
Jusqu’à la Renaissance, aucune distinction n’était faite entre l’art et l’artisanat telle qu’elle est faite de nos jours. Aujourd’hui, la différence entre les deux nous paraît évidente. Pourtant Joy Sorman réussit dans ce très (trop) court roman à rendre aux métiers de la boucherie leurs lettres de noblesse surtout dans le contexte actuel où la consommation de viande est de plus en plus critiquée. 
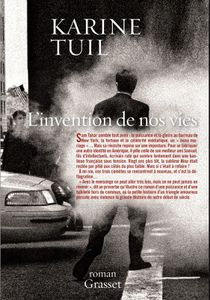 Nous évoluons dans une société de plus en plus individualiste et matérialiste. Les maîtres mots sont réussite et performance. Pour beaucoup, il s’agit surtout de réussir socialement, se faire une place, une situation. Avoir un bon emploi et un bon salaire. Avoir une belle voiture, une belle maison, les gadgets électroniques dernier cri. Avoir un conjoint, de beaux enfants dont on exige de beaux bulletins scolaires. Et surtout, on aime particulièrement obtenir l’estime et le respect des autres voire même susciter l’envie.
Nous évoluons dans une société de plus en plus individualiste et matérialiste. Les maîtres mots sont réussite et performance. Pour beaucoup, il s’agit surtout de réussir socialement, se faire une place, une situation. Avoir un bon emploi et un bon salaire. Avoir une belle voiture, une belle maison, les gadgets électroniques dernier cri. Avoir un conjoint, de beaux enfants dont on exige de beaux bulletins scolaires. Et surtout, on aime particulièrement obtenir l’estime et le respect des autres voire même susciter l’envie. 
 Je risque de ne pas être très tendre avec ce livre assez court qui pourtant partait sur un bon concept mais dont la réalisation m’a beaucoup déçue.
Je risque de ne pas être très tendre avec ce livre assez court qui pourtant partait sur un bon concept mais dont la réalisation m’a beaucoup déçue.  Participer au bouzkachi royal de Kaboul, chevaucher à travers les hauts sommets et les vallées de l’Hindou-Kouch, parcourir les allées du bazar et rester bouche-bée devant les gigantesques statues de Bouddha à Bamiyan, croiser la longue caravane des nomades Pachtous, se régaler les yeux du jeu de miroir des 5 lacs de Band-Y-Amir, courir au grand galop cheveux au vent à travers les steppes du Nord de l’Afghanistan, vivre une incroyable aventure humaine où se combattent fierté, honneur, cupidité, voilà ce qui vous attend à la lecture du magnifique roman Les cavaliers de Joseph Kessel.
Participer au bouzkachi royal de Kaboul, chevaucher à travers les hauts sommets et les vallées de l’Hindou-Kouch, parcourir les allées du bazar et rester bouche-bée devant les gigantesques statues de Bouddha à Bamiyan, croiser la longue caravane des nomades Pachtous, se régaler les yeux du jeu de miroir des 5 lacs de Band-Y-Amir, courir au grand galop cheveux au vent à travers les steppes du Nord de l’Afghanistan, vivre une incroyable aventure humaine où se combattent fierté, honneur, cupidité, voilà ce qui vous attend à la lecture du magnifique roman Les cavaliers de Joseph Kessel.  4ème de couverture (modifiée par mes soins):
4ème de couverture (modifiée par mes soins):  J’ai fait la connaissance de Jules Barbey d’Aurevilly lorsque j’étais encore au lycée. Notre prof de français nous avait demandé de lire Une vieille maîtresse. Je me souviens d’avoir beaucoup apprécié cette lecture malgré une première moitié du livre ennuyeuse à mourir et qui aura eu raison du peu de courage de mes camarades de classe de l’époque. Mais pour les quelques rares téméraires qui ont poursuivi la lecture jusqu’au bout, leur volonté aura été récompensée par une deuxième moitié absolument passionnante pour laquelle je me rappelle mon enthousiasme.
J’ai fait la connaissance de Jules Barbey d’Aurevilly lorsque j’étais encore au lycée. Notre prof de français nous avait demandé de lire Une vieille maîtresse. Je me souviens d’avoir beaucoup apprécié cette lecture malgré une première moitié du livre ennuyeuse à mourir et qui aura eu raison du peu de courage de mes camarades de classe de l’époque. Mais pour les quelques rares téméraires qui ont poursuivi la lecture jusqu’au bout, leur volonté aura été récompensée par une deuxième moitié absolument passionnante pour laquelle je me rappelle mon enthousiasme. 



